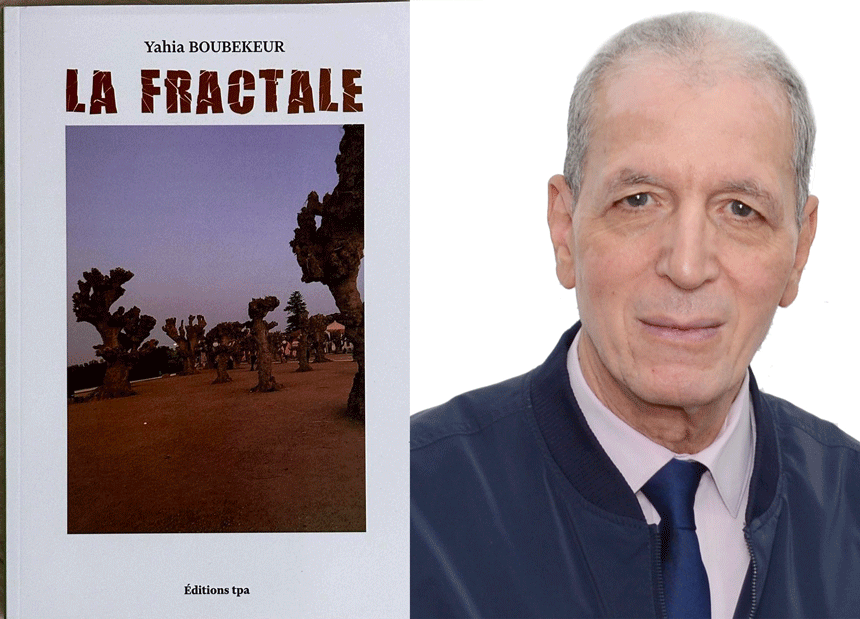L’auteur Yahia Boubekeur vient tout juste de publier aux éditions TPA son dernier roman intitulé La Fractale. Un livre de 235 pages qui convoque les dates phares de l’histoire de l’Algérie. Dans cet entretien, Yahia Boubekeur nous parle de son livre, de sa façon d’écrire, de son ressenti de la bataille sanglante qu’a enduré le peuple algérien durant la colonisation.
Propos recueillis Par Nacima Chabani
Après la publication de Mon Algérie à moi : la voie de Biskra en 2021, vous signez un nouveau livre intitulé La Fractale sur la résistance algérienne ? Pourquoi le choix de ce titre et du thème ?
Il s’agit en fait du troisième ouvrage. Après la voie de Biskra, j’ai publié Le café Malakoff dans lequel je convoquais à ma table le sinistre Aimable Pélissier. Je me référais à son histoire pour écrire celle des victimes. De son témoignage et de ses correspondances, je prélevais les râles du dernier souffle de vie de la tribu qu’il avait éteinte. C’est l’histoire des victimes que je peints avec des mots. Des victimes sans noms. Sans traces. Abandonnées et enterrées sur place. Des victimes effacées de l’histoire du revers de la main, et dont on ne saura jamais rien. Le café Malakoff, c’est un tableau plus sombre que celui peint dans le chaos du bombardement de Guernica. Un carnage qui se jouait à huis clos. Une douleur muette, silencieuse, enfermée dans les gorges des victimes étranglées. L’holocauste avant l’holocauste.
Les deux ouvrages se rejoignent et se complètent pour traduire la rage coloniale de venir à bout du socle tribal de la résistance. Ce corps social dans lequel les tribus interagissaient pour former ce «tout indigène» inébranlable. Tous les colonisateurs s’étaient donné comme objectif de le détruire. Si les Romains expropriaient les Berbères sédentaires de leurs terres pour les attribuer aux Berbères nomades, ils ne cherchaient pas moins que d’inverser les rapports des hommes à la terre. De ce désordre, il en résulta que les peuples sédentaires étaient jetés sur les routes affamés et les peuples nomades qui s’engageaient dans l’armée de Rome, moyennant des lopins de terre et la nationalité romaine, finissaient dans la déchéance. Ils subissaient un fait d’histoire qui se reproduit dans la fatalité de la conquête. La guerre de Rome contre la Numidie rejoint celle de la France contre l’Algérie dans son mode opératoire : exterminer le peuple «indigène», nomades et sédentaires confondus. Et ce sont ces faits d’histoire qui se reproduisent qui justifient le titre de mon troisième ouvrage, La Fractale.
Ce livre, dont vous avez entamé l’écriture durant la pandémie de Covid-19 se décline sous la forme d’un voyage plurielle à travers plusieurs villes symboliques de l’Algérie où les batailles sanglantes des colons sont mises à l’honneur ?
Oui, je crois, et pardonnez-moi ce cynisme. La pandémie qui avait brisé bien des carrières m’avait libéré de mes chaînes. Sans me rendre compte, c’étaient les mots qui se collaient à moi. Ils se détachaient des paysages que je parcourais dans mon cheminement à travers l’histoire. C’était pour cela que je replongeais dans les villes de Blida, Médéa pour détecter ce fait d’histoire qui avait accéléré notre défaite. En m’interrogeant sur le double viol colonial. La pénétration française et la trahison turque, j’ai cru déterrer la loi visible dans cet arbre de mort qui pousse dans notre vie. Il suffit d’examiner le parcours de chacun de nous pour démêler les faits de revanche et de trahisons, qui nous avaient façonnés si méticuleusement que nous les reproduisîmes, à notre tour dans des arabesques de rage. Des figures de traîtrise, d’abus et de besoin de vengeance. L’esquisse du modèle dramatique qui nous façonne depuis la trahison de Jugurtha, de l’émir Abdelkader et Abane Ramdane. La fractale est un voyage à travers les villes de Blida, Médéa, Barrouaghia, Boghar, Zoubiria jusqu’à Ain Taguin qui avait abrité la Smala pour la première et la dernière fois. Et chacune d’elle se définit par une bataille sanglante incontournable.
Vous vous attardez longuement sur la ville de Médéa avec la douloureuse date du 21 novembre 1830 ?
Cette date était déterminante pour la suite de la colonisation. Pendant que les soldats français s’en prenaient aux villageois de Soumata, le bey Boumezreg négociait sa soumission. De simples hameaux accrochés au flanc de la montagne, que Clausel brûlât systématiquement. Leur mort brutale en cette morne matinée grise était un gage de loyauté à ces montagnes trahies, à ces arbres qui couraient dans la forêt. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, sabrés, tués et brûlés, pour la seule richesse qu’ils possédaient et qu’ils refusaient de négocier. Leur Liberté. Les soldats français, fiers de ces carnages, se comparaient, dans leur bivouac, aux romains, dans le tumulte de l’histoire qui se répétait. Médéa est un territoire varié de faune et de flore, de villes et de villages. Un mélange de genre, de langages, de plaines et de montagnes. Ce sont des noms qui viennent de loin. Des noms qui s’additionnent et qui se regroupent dans un mélange explosif qui draine dans nos veines cette envie maladive d’exister. C’est le cœur de la wilaya IV qui porte la résistance comme une marque de fabrique. Je revois les paysans emmitouflés dans des kechabias chaudes, les têtes munies de turbans, posés comme des couronnes royales. Je revois Hassan El Hassani, qui se faufile dans ma mémoire avec l’élégance populaire qu’il incarne. C’est l’image du paysan algérien honnête que la naïveté avait façonné méticuleusement. Le personnage Boubegra cadre parfaitement avec ces hommes qui vont chaque matin à l’assaut de l’essentiel.
La capitulation d’Hussein Dey en 1830, l’assassinat de Selim Eutemi, sultan d’Alger et la mort de son épouse, Zaphira, occupe une place de choix dans votre livre…
La capitulation du Dey Hussein met fin à trois siècles d’un pouvoir despotique ottoman. Les tribus, naguère divisées, trouvent dans la conquête coloniale le ciment de l’unité. Le règne des ottomans commence par une trahison, et se clôt par une imposture. Une histoire de blé livré à l’armée de Napoléon, d’une dette non réglée et d’un chasse-mouche déplacé qu’on raconte aux écoliers. Zaphira, la veuve du sultan d’Alger, endeuillée, s’enferme dans le deuil et la vertu qui siéent à son rang. Ne pouvant échapper à son bourreau, elle avale une potion toxique pour s’affranchir de sa tyrannie. Dignement, elle refuse l’abominable mariage avec l’assassin et rejoint le destin de Kahina. La femme sauvage. La femme refuge. La femme reine.
Vous évoquez tous les crimes commis par le colonisateur français et les défaites subies avec force et détails. Vous soutenez aussi que c’est parce qu’aucun peuple au monde n’a survécu par les défaites que vous ressentez cette sensation de bien-être particulière pour reproduire cette procession de victimes coloniales et post-coloniales qui avaient sauvé l’essentiel ?
En ce qui nous concerne, c’est toujours la même histoire de lutte et de survie. Une histoire de combat, de bataille et de résistance. Une histoire d’adaptation, d’adoption et de camouflage qui se dénoue à la fin par la survie du peuple fondamental. Le peuple algérien. C’est pour cela que je remonte à la surface après ce plongeon dans l’histoire des crimes commis et des défaites subies avec une sensation de bien-être qui adoucit ma colère. Je rejoins cette procession de victimes gonflée par les nouveaux réfugiés subsahariens qui remontent vers le Nord dans le sens inverse de l’histoire. Un mouvement d’affranchissement de l’humanité des siècles obscures. Une revanche du faible sur le fort, de la victime sur le bourreau dans un mouvement de l’histoire qui obéit à la loi du tout. Des fugitifs en mouvement désordonné. Des flèches qui foncent devant, dans un jet violent de délivrance. Des débris de la guerre. Des bombes.
La Fractale est un ouvrage riche en informations. Avez-vous eu recours à la documentation et aux archives pour élaborer ce projet d’écriture ?
La Fractale n’est pas un ouvrage d’histoire, même si je me suis astreint à un travail de recherche documenté et méticuleux. C’est un voyage, et à ce titre, ce sont les lieux qui déterminent les recherches. C’est une fois que ma tête est pleine d’images, d’informations et d’inspiration que je me mets à écrire et à me documenter. Ce n’est pas un livre de littérature, même s’il est écrit avec des mots soigneusement choisis. Ce n’est pas un livre de géographie, non plus, même s’il est riche en informations sur les reliefs, les oueds, les villes, sur l’Atlas, Keflakhdar et Ichar qu’on appelle actuellement Achir. C’est tout ça à la fois, car je suis impressionné par la théorie du tout. Les approches segmentaires pour appréhender l’histoire restent pour moi insuffisantes, partielles et partiales. Sans doute que je pose, inconsciemment ou consciemment, la problématique de l’histoire. Nous faisons l’histoire, mais nous la subissons.
Au-delà de toutes les souffrances du peuple algérien durant la guerre de Libération nationale, vous faites un clin d’œil à l’artiste peintre algérienne Baya Mohiédine ?
J’aime beaucoup Baya. Au-delà des mots, j’aime les traits que je suis incapable d’aligner. Cette carence me pousse à les chercher chez les autres. Baya surgit dans ma tête à la sortie de Blida. Une étoile filante. Une fleur sauvage qui s’épanouit dans les toiles qu’elle tisse dans un environnement de braise. Elle surgit dans ma tête comme une caresse avec les mots et les peintures qui se mélangent, qui se regroupent et qui explosent dans ses compositions. Orpheline à l’âge de 16 ans, elle me fait penser à ces millions de jeunes filles, que la colonisation avait privées de savoir pour les abandonner, assises aux seuils des mosquées, «malgré le froid et la bise, jusqu’à la fin du jour».
Sinon avez-vous un autre projet d’écriture ?
Oui, j’ai plusieurs ouvrages que je publierai progressivement dans la collection Mon Algérie à moi. Le prochain se déroulera à Alger au regard des circonstances qui m’avaient conduit à marcher beaucoup. Je trouve enfin le temps d’examiner les places et les rues qui abritent notre mémoire cachée.
Bio-express
Yahia Boubekeur, né à l’indépendance, à Aït Gharbit, à Tizi Gheniff (Tizi Ouzou), a exercé comme enseignant, bibliothécaire, journaliste, puis comme cadre dirigeant dans une entreprise publique. Un cheminement qui le mène dans une autre voie qu’il traduit dans la délivrance. L’écriture. Une magie de mots qui le replonge dans l’histoire que les hommes avaient recouverte de poussière.