Historien et docteur à l’université de Cambridge (thèse de doctorat soutenue en 1972 sur le Jansénisme français), Neil MacMaster enseigne, au début de sa carrière, l’histoire européenne. Dès les années 1980, il s’intéresse à l’Algérie contemporaine dont il devient un spécialiste reconnu. Ses recherches ont porté en particulier sur la période coloniale et la Guerre de Libération et ont abordé les thèmes de l’émigration algérienne, du racisme et de l’antiracisme en France, du statut et du rôle des femmes dans la Guerre de Libération, de la pratique par l’Etat français de la «terreur d’Etat».
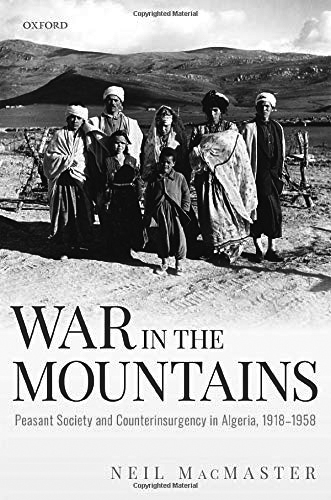
(La Guerre dans les djebels. Société paysanne et contre-insurrection en Algérie (1918-1958)
Auteur de nombreux articles et ouvrages, il a publié avec le professeur Jim House, Paris 1961. Les Algériens, la terreur d’État et la mémoire (Paris: Tallandier, 2008), et plus récemment Burning the Veil. The Algerian War and the «emancipation» of muslim women, 1954-62 (Manchester : Manchester University Press 2009).
Neil MacMaster est maître de conférences honoraire à l’Ecole d’études politiques, sociales et internationales de l’université d’East Anglia (Norwich).
- Vos recherches portent depuis de nombreuses années sur la colonisation française de l’Algérie et sur la guerre d’indépendance en Algérie et en France. Comment vous, Britannique, en êtes arrivé à vous intéresser à un champ historique qui est loin des préoccupations de votre pays ?
Je m’intéresse depuis longtemps à l’histoire et à la sociologie de la migration internationale, un intérêt qui découle en partie de mon expérience personnelle lorsque, à l’âge de 12 ans, mes parents ont décidé d’émigrer d’Angleterre au Canada. Bien que cela n’ait pas marché pour eux, et que nous soyons retournés en Angleterre un an plus tard, l’étrange choc psychologique et culturel de la vie dans une société très différente m’est toujours resté en mémoire. Lorsque j’étais étudiant à Paris en 1969, j’ai travaillé pendant un certain temps comme ouvrier dans une usine de peinture à Stains et j’ai loué une minuscule chambre dans un café partagé par des immigrés marocains ; j’avais donc une sorte d’empathie avec le monde des migrants dont j’ai brièvement partagé l’existence.
Dans les années 1980, je donnais des cours sur l’histoire de la migration internationale vers l’Europe (des Caraïbes, de l’Inde, du Pakistan, de l’Indochine et d’ailleurs) et j’ai décidé de mener un projet de recherche plus détaillé sur l’Algérie, que j’ai visitée pour la première fois en 1988. J’ai choisi l’Algérie parce que la migration de travail vers la France après 1900 était l’une des plus anciennes et des mieux documentées, et mes conclusions ont finalement été publiées sous le titre Migrants coloniaux et racisme. Les Algériens en France, 1900-62 (1997). Dans cette étude, je me suis particulièrement intéressé à ce que Abdelmalek Sayad appelait la «noria», c’est-à-dire l’interrelation continue et circulaire entre la société d’origine, comme les villages de Kabylie, et la vie des travailleurs algériens dans les bidonvilles industriels de Paris et d’ailleurs.
- N’est-il pas plus difficile pour un historien de travailler sur un champ historique étranger à son pays d’origine ? A moins que cette distance soit, au contraire, favorable au regard neuf du chercheur ?
Dans un sens, il est peut-être plus difficile pour un historien de faire des recherches sur une société très différente de la sienne, mais d’un autre côté, il ou elle peut être en mesure d’apporter à la tâche de nouvelles idées ou des perspectives comparatives inconnues dans le domaine de la recherche franco-algérienne. Par exemple, à partir des années 1960, j’ai été très influencé par le révolutionnaire historien britannique E. P. Thompson (auteur de The Making of the English Working Class), qui a fourni une nouvelle approche de la résistance des ouvriers et des travailleurs agricoles au XVIIIe siècle aux impacts destructeurs du capitalisme industriel. Les travaux de Thompson et d’autres historiens sur le mouvement des enclosures, la saisie des terres de la paysannerie et, en particulier, le concept «d’économie morale», m’ont fourni une boîte à outils qui m’a aidé à jeter une lumière dynamique sur la façon dont le colonialisme français a saisi les terres des Algériens.
- Le sociologue Aïssa Kadri, qui a consacré une analyse à votre ouvrage La Guerre dans les djebels. Société paysanne et contre-insurrection en Algérie (1918-1958) aux éditions Oxford, le qualifie d’«ouvrage majeur qui réinterroge et renouvelle les approches socio-historiques sur la guerre d’Algérie». Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l’originalité de votre recherche par rapport à d’autres portant sur la paysannerie algérienne ?
Les histoires et commémorations «officielles» de la guerre d’indépendance algérienne présentent la paysannerie, qui constituait la majorité du peuple algérien, comme un acteur majeur, mais généralement comme une masse héroïque, stéréotypée. Mais lorsque j’ai commencé à enquêter sur une «histoire d’en bas», c’est-à-dire sur la manière dont les populations rurales ont vécu le colonialisme et sont entrées en résistance, j’ai été surpris de constater que l’on savait très peu de choses sur la vie à l’intérieur du pays (bled). Dans les années 1960, des chercheurs comme Pierre Bourdieu considéraient les paysans comme incapables de conscience politique, une classe qui ne pouvait être conduite vers la révolution que par un parti d’avant-garde urbain. En ce sens, on considérait que les paysans, incapables de s’organiser, méritaient à peine d’être étudiés. Mes propres recherches, s’appuyant sur l’ouvrage pionnier de Mostefa Lacheraf de 1965 (L’Algérie : nation et société), ont montré que la société rurale possédait une culture sociopolitique autonome, notamment sous la forme de l’assemblée villageoise (djemâa).
- Quels sont les facteurs qui ont favorisé la diffusion des idées nationalistes, après les années 1930 en milieu rural ? Comment ensuite le FLN a pu s’implanter parmi la paysannerie ?
Après les années 1930, les mouvements nationalistes et socialistes qui avaient construit une base organisationnelle, principalement à Alger, Oran et d’autres centres urbains, se sont progressivement rendu compte qu’ils devaient étendre leurs réseaux dans les zones isolées de l’intérieur. Dans les petites villes de la vallée du Cheliff, par exemple, les militants commencent à prendre contact avec les paysans le jour du marché, ou envoient des agents en bus ou via les camionnettes des petits commerçants dans les montagnes. Lorsque les nationalistes ont commencé à se tourner vers la formation de l’Organisation spéciale armée après 1947, ils ont découvert que les paysans possédaient déjà un haut niveau de cohésion sociale et politique. Les militants inexpérimentés du FLN, qui tentaient de survivre dans les conditions difficiles de l’intérieur, ont rapidement découvert qu’au lieu d’imposer leur propre idéologie ou leurs propres formes d’organisation, basées sur les villes, ils devaient s’adapter ou se fondre dans les solidarités familiales, parentales et communautaires préexistantes de la paysannerie. Les structures du FLN au niveau local ont donc été construites par alliance avec les djemâa, ou se sont simplement approprié la machinerie coloniale locale du gouvernement en gagnant les populations et en éliminant les médiations coloniales, les caïds et les chefs de fraction.
- Comment expliquez-vous que le pouvoir colonial, malgré tous les moyens qui étaient les siens (action psychologique, répression...), n’ait pas pu prendre le contrôle de la paysannerie ?
Le colonialisme français, comme celui des Britanniques en Inde et en Afrique, n’avait tout simplement pas la main-d’œuvre nécessaire pour contrôler et administrer de vastes régions géographiques et des millions d’habitants. La France, comme les autres puissances impériales, s’appuyait généralement sur un système de gouvernement indirect, de sorte que pour l’administration de l’intérieur (maintien de l’ordre, collecte des impôts, recrutement de l’armée, renseignement...), elle dépendait de fonctionnaires indigènes, tels que les caïds. Le talon d’Achille du colonialisme français était le fait que le contrôle colonial des douars était toujours fragile : dans la commune mixte du Chelif en 1946, pour 77 colons habitant des fermes fortifiées, le nombre d’Algériens était plus massif, soit 127 792 Algériens. Les Français peuvent parfois déclencher une répression armée, comme à Sétif en 1945, mais les militants paysans ont érodé progressivement le pouvoir des caïds, de sorte qu’en 1954, l’administration coloniale a perdu le contrôle de l’intérieur. La transmission quotidienne de renseignements depuis les douars, via les caïds, jusqu’à l’administration coloniale centrale, commençait à se tarir et ne fournissait plus les informations précises nécessaires au maintien du pouvoir colonial.
- Vous qui avez travaillé sur la région du Cheliff, comment a été construite la contre-insurrection de l’opération «Pilote». Sur quels principes et comment a-t-elle été déployée et pourquoi a-t-elle échoué ? Quelle place avait le «maquis rouge» ?
L’opération «Pilote», vaste expérience de «pacification», s’inspire de la doctrine de la guerre révolutionnaire, selon laquelle la domination coloniale repose moins sur la force militaire conventionnelle que sur la conquête de la population civile, afin de détruire la base de soutien du FLN. Le plan directeur, élaboré par l’ethnologue Jean Servier, visait à gagner les paysans de montagne par des réformes communales qui reproduisaient les structures de base des djemâa qui ont fait le succès du FLN. Le projet «Pilote», malgré les prétentions d’Alger à la réussite, a rapidement échoué pour un certain nombre de raisons. De nombreux commandants de l’armée ne voulaient pas coopérer avec les nouvelles méthodes de guerre psychologique, tandis que les militaires étaient incapables de consolider et de contrôler les communes, les populations dispersées des montagnes, qu’ils prétendaient libérer. Un signe de cet échec a été le passage à une politique visant à isoler le maquis du FLN de sa base de soutien, par le déplacement violent de la population des montagnes vers les camps de réfugiés de regroupement.
Le «maquis rouge», situé dans les montagnes de l’Ouarsenis, n’a pas non plus réussi à planifier et à préparer soigneusement la logistique d’une base de guérilla, ce qui a entraîné un manque d’armes, de fournitures et de soutien des paysans locaux. Ces maquisards ont également attiré l’attention de l’armée française en tuant imprudemment plusieurs «collaborateurs» et, en quelques semaines, l’ensemble du maquis a été détruit. La guérilla communiste, largement méconnue, créée par Mohamed Zitoufi à l’est de Ténès, et qui a fini par se fondre dans le FLN, a eu beaucoup plus de succès.
- Dans un précédent ouvrage écrit à avec Jim House (Les Algériens, la terreur d’Etat et la mémoire, Paris 1961, Paris, Tallandier, 2008, réédité chez Casbah en Algérie), vous faites le lien entre les violences en Algérie et celles en métropole, en croisant l’histoire coloniale, celle de l’émigration et celle de la police. Comment est organisée cette violence coloniale ? Quels en sont ses modalités ? Ses objectifs ? Une violence coloniale qui culminera avec la répression sanglante de la manifestation pacifique des Algériens de Paris et de sa région du 17 Octobre 1961...
Au cours du XXe siècle, les gouvernements français et britanniques ont élaboré des politiques visant à former des communautés permanentes d’immigrants dans les métropoles. Ils ont invariablement nommé d’anciens coloniaux et officiers de l’armée comme conseillers, policiers, responsables du logement, travailleurs sociaux et autres personnes qui prétendaient avoir une connaissance «spécialisée» de la langue, des coutumes et de la «mentalité» des «indigènes».
Les formes organisationnelles de police raciste qui se sont développées librement dans les colonies sont «importées» au cœur de l’empire. Maurice Papon, nommé préfet de police en mars 1958, introduit des officiers supérieurs des SAS ainsi que des unités de «harkis» pour injecter les méthodes de contre-insurrection, y compris la torture, développées en Algérie. Papon était frustré de ne pas pouvoir déployer en France métropolitaine les techniques répressives violentes du Maghreb colonial, mais cela ne l’a pas empêché de donner son feu vert à de telles pratiques.
En particulier, Papon est allé bien au-delà des opérations de police visant à localiser et à éliminer les cadres du FLN, pour harceler et épuiser l’ensemble de la communauté algérienne par des opérations visant à terroriser et à déstabiliser par le biais d’arrestations massives, de descentes nocturnes dans les bidonvilles, de «déportations» en Algérie et de la brutalité systémique des «bidules». Le 17 Octobre, la police parisienne était bien préparée à prendre sa «revanche» sur les manifestants algériens pacifiques.
- Vous vous êtes aussi intéressé au statut et au rôle des femmes dans la Guerre de Libération de l’Algérie. Diriez-vous qu’une fois l’indépendance acquise, les femmes sont les oubliées de l’histoire, dans la mesure où peu d’études leur ont été spécifiquement consacrées ?
Il n’est peut-être pas tout à fait exact de dire que les femmes algériennes d’après 1962 ont été oubliées par les historiens, car il y a eu un volume considérable de travaux sur ce sujet (entre autres les recherches de D. Amrane, M. Charrad, M. Gadant, M. Lazreg, R. Seferdjeli, Lacoste-Dujardin, N. Vince, L. Pruvost...). Comme on le sait, les mouvements révolutionnaires ou les guerres totales ont souvent conduit à une «émancipation» temporaire des femmes qui, dans l’urgence d’une lutte à mort, ont accepté des emplois à prédominance masculine dont elles étaient auparavant exclues, ou ont pris les armes et joué un rôle clé dans les maquis ou la résistance clandestine.
Mais, la guerre terminée, les nouveaux régimes, y compris celui du FLN, ont insisté pour que les femmes retournent au foyer et que le statu quo d’avant-guerre du patriarcat conservateur soit restauré. Ce que révèlent des historiens et des sociologues comme Lahouari Addi, c’est la manière dont l’Etat post-indépendance n’a pas pu remettre en cause ou se défaire du poids exceptionnel de la famille patriarcale «traditionnelle» et il a fallu 22 ans pour aboutir à un code de la famille profondément conservateur.
Cela soulève la question complexe et extrêmement importante de savoir dans quelle mesure la Révolution a marqué un tournant significatif dans les structures sociales profondes du genre ou, au contraire, a montré des continuités qui ont ancré le patriarcat dans la modernité algérienne.
Propos recueillis par Nadjia Bouzeghrane



