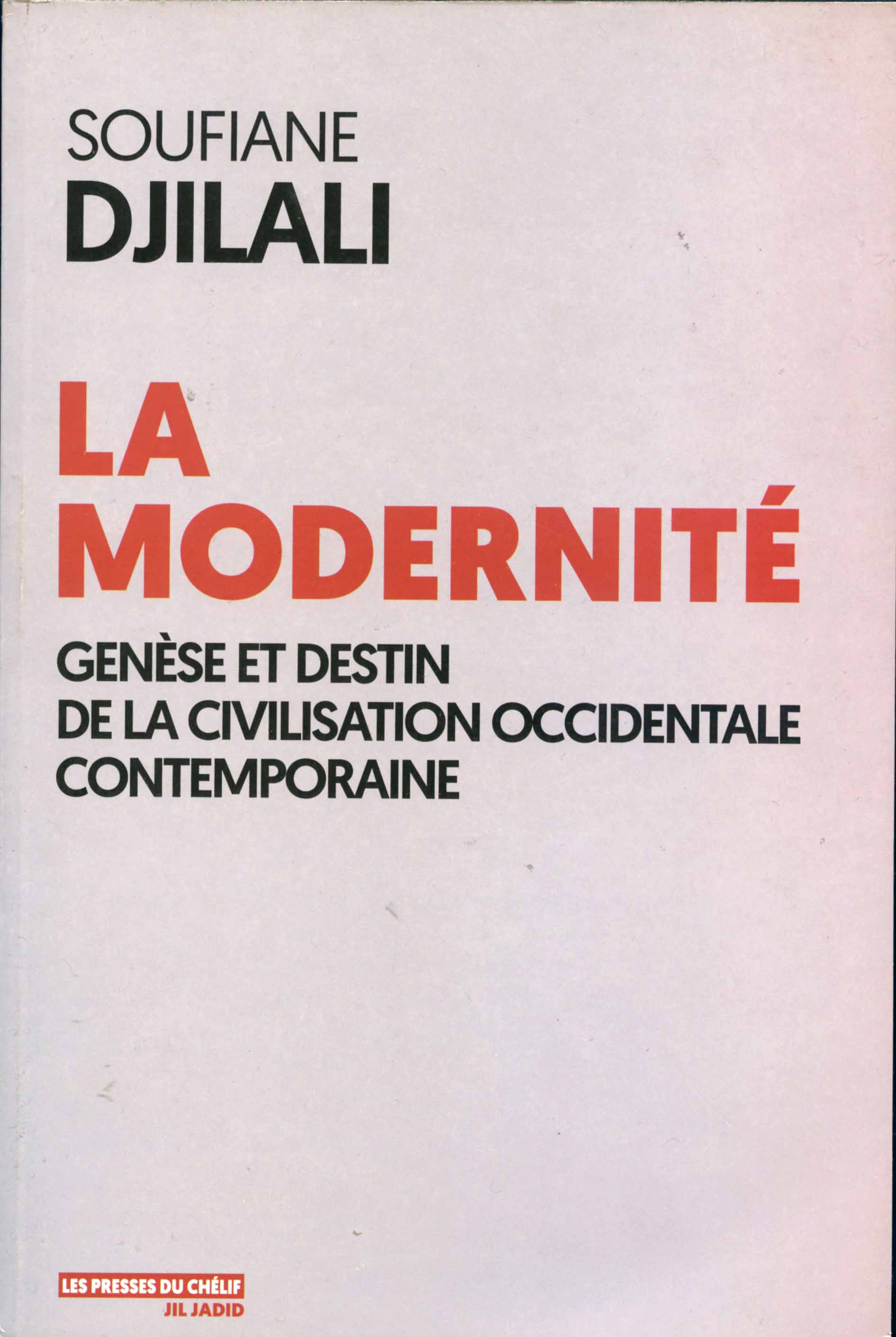La modernité n’est pas tombée du ciel ni n’a émergé d’un ou de plusieurs esprits brillants qui auraient conçu, dans un laboratoire, un plan particulièrement ingénieux pour l’offrir à l’Occident. Elle est en fait le résultat d’une réalité anthropologique, mentale, politique, historique et géographique des peuples de l’Europe occidentale.»
Ainsi s’ouvre la première partie du nouvel essai de Soufiane Djilali portant sur un thème fort de l’histoire des idées politiques : la modernité. L’auteur, qui a écrit un précédent essai sur la modernité en contexte algérien, revient sur un thème qui a préoccupé les penseurs arabes depuis la Nahda, et continue d’occuper les débats actuels.
Intitulé : La modernité, genèse et destin de la civilisation occidentale contemporaine, l’ouvrage se propose d’aider à «comprendre comment est apparue la modernité et quelles en sont les conséquences politiques, psychologiques, culturelles et économiques». Qu’est-ce que la modernité ? Quels en sont les «piliers» ? Que fait-on d’un «modèle» proposé par un Occident concurrent ? La modernisation, menée à pas de charge depuis Mehemet Ali, est-elle davantage subie que souhaitée ?
Soufiane Djilali reconnaît que la modernité est un «processus complexe» qui s’est constitué tout au long des cinq derniers siècles, dans un espace géographique déterminé : l’Occident. «Elle a pris d’abord appui sur une civilisation traditionnelle d’Empire», affirme-t-il. «La première étape fut l’affaiblissement du pouvoir religieux et l’instauration des Etats-nation. Les contradictions internes de l’Eglise aboutirent à une contestation endogène qui la brisa en deux.»
«Hubris occidental»
Ce modèle concurrent est-il accepté par les autres civilisations ? Pour l’essayiste, ces dernières ont «subi, à leur corps défendant, cette domination tout en refusant de s’y résigner». «Ils (autres peuples, ndlr) sont à l’évidence admiratifs devant les incroyables prouesses scientifiques, technologiques et industrielles de l’Occident. Cependant au fond d’eux-mêmes, ils rejettent l’hubris occidental même si paradoxalement ils succombent, de plus en plus et au moins partiellement, à sa vision du monde», relève S. Djilali, s’interrogeant sur ce «double effet, attirance et rejet». La guerre génocidaire menée à Ghaza par un allié de l’Occident fragilise davantage un modèle déjà discrédité.
Ayant abordé dans un précédent essai la crise algérienne des années 1990, l’auteur est convaincu que la «violence avait émergé avec une puissance destructrice, durant les années 90, de la contradiction violente et irréductible entre la société traditionnelle et la modernité occidentale dont les valeurs et les normes s’étaient infiltrées massivement et de manière incontrôlable dans l’imaginaire populaire».
Soufiane Djilali a un mérite : il est un des rares hommes politiques algériens à écrire et à proposer, depuis plusieurs années, une radiographie de la société, assumant une filiation intellectuelle claire : la pensée forgée par le penseur Malek Bennabi.
Avec son nouvel essai, l’ancien SG du Parti du renouveau algérien (PRA), dont la maîtrise de la langue est indéniable, privilégie une approche didactique qui aide le lecteur à mieux aborder l’essai : présentation à chaque fin de chapitre un résumé des idées «à retenir».
L’auteur promet en conclusion de proposer un prochain ouvrage, qui permettra d’«entreprendre une comparaison, (…) entre l’évolution du monde musulman et la modernité occidentale et en inférer les possibilités de concevoir un projet de société pour notre pays».
Un bémol : les références privilégiées dans l’essai laissent le lecteur sur sa faim (Freud, Jung, Gauchet et même un essayiste controversé, Thierry Meyssan). Toute une vaste littérature «moderniste» et «postmoderniste» est négligée. S’y référer devra permettre de renouveler le savoir sur un sujet important.
Soufiane Djilali, La modernité, genèse et destin de la civilisation occidentale contemporaine.
Les Presses du Chélif, Jil Jadid, 2024. Prix 1200 DA
EXTRAIT
« La question de la troisième voie »
« […] Mais la question la plus urgente en ce début de l’année 2024 est de savoir si l’Occident peut accepter d’exister en tant que civilisation parmi d’autres ou s’il exige définitivement d’être l’unique civilisation appelée à dominer tous les autres peuples ? Et, au cas où le Sud global se révolte, que l’axe Russie-Chine-Iran assure sa propre souveraineté, se résoudra-t-il devant cet échec ou entraînera-t-il le monde dans l’apocalypse ? Et si l’Occident venait à s’effondrer en tant que civilisation, les pays comme la Chine, la Russie, l’Inde, le Brésil, etc… qui ont réussi quelque peu à reproduire la dimension matérialiste, industrielle et technologique que lui ? Ne voudront-ils pas, à leur tour dominer le monde et imposer un hégémonisme selon leurs règles ? Ou bien sauront-ils accepter de relativiser leur puissance et donner un sens existentiel à leurs peuples et aux peuples du monde en dehors de l’hubris ?
La question de la troisième voie est pour l’instant sans réponse.»