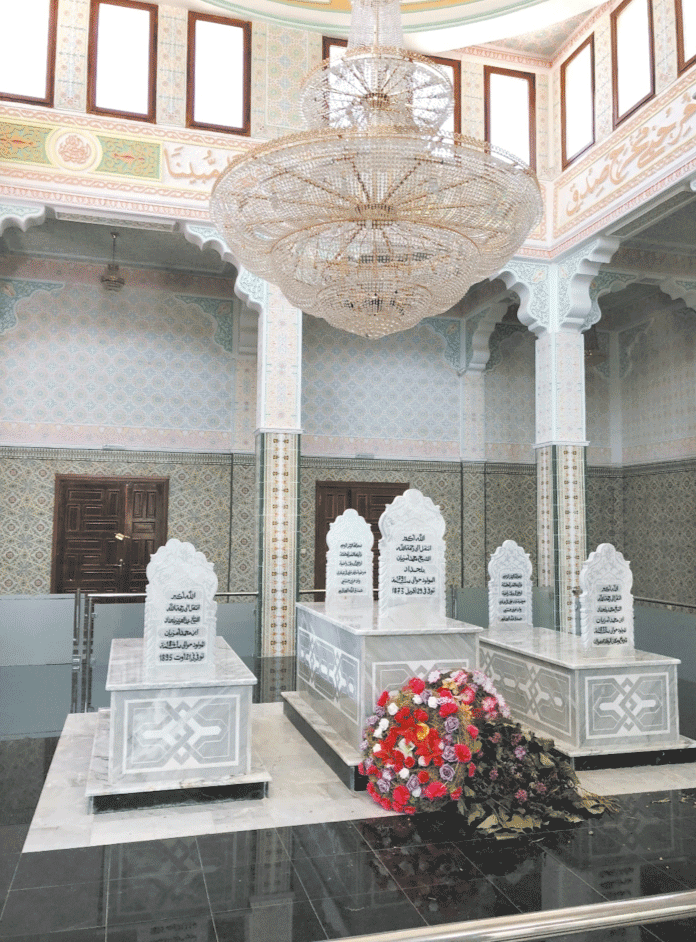En 1871, Cheikh El Haddad appelle à l’insurrection lors d’un rassemblement à Seddouk (Petite Kabylie à l’époque) et proclame la guerre sainte (le djihad) contre l’envahisseur français.
Dans le maintien de la flamme nationaliste qui a permis d’aboutir par ce cycle de soulèvements allant des événements du 8 Mai 1945 à la Guerre libératrice déclenchée par la Révolution du 1er Novembre 1954, les mouvements insurrectionnels populaires ont marqué une étape décisive, comme un relais essentiel entre les résistances armées de l’Emir Abdelkader, les El Haddad/Mokrani et le Mouvement de libération nationale du XXe siècle. Le soulèvement de 1871 est considéré parmi les plus importantes révoltes populaires et comme la dernière insurrection véritablement militaire avant celle du 1er Novembre 1954.
Cette révolte de 1871 a été déclenchée par Mohamed El Mokrani alors Bachagha de Medjana, un mouvement insurrectionnel appuyée par le Cheikh El Haddad, guide spirituel de la Tarika Errahmania établie à Seddouk (Algérie). Dès la prise d’Alger en 1830, la résistance populaire s’est construite autour d’un nationalisme religieux et féodal.
La France se heurta, dès le début, à des forces plus importantes notamment celle de Ahmed Bey de Constantine vaincues après deux campagnes difficile (1836-1837).En 1832, L’Emir Abdelkader proclame le Djihad contre les français et devient leur plus dangereux adversaire.
Entre le 18 et le 21 juin 1845, le scandale des «enfumades» des grottes de Ghar El Frachih dans le massif du Dahra à Mostaganem fut le théâtre d’une odieuse extermination massive de populations civiles de la tribu de Ouled Riah. Le 22 février 1848, le peuple de Paris se soulève contre la monarchie. Alger, Oran et Constantine deviennent des départements français. C’est le début des soulèvements. Il y a d’abord la Résistance des insurgés de Zaâtcha (Biskra : 1848-1849), menée par Cheikh Ahmed Bouziane, le chef de l’Insurrection des Zibans, dans l’Est de l’Algérie, capturé, fusillé puis décapité. Sans oublier, le célèbre Sultan «Boubaghla» (l’homme à la mule), initiateur d’une révolte populaire, tué en 1854. Le «chacal» général Saint-Arnaud, en Petite Kabylie, écrit : «J’ai laissé sur mon passage un vaste incendie, tous les villages, environ 200, ont été brûlés ; tous les jardins saccagés, les oliviers coupés…».
De 1854 à 1855, le général Randon en Kabylie va combattre une femme exceptionnelle Lalla Fatma N’Soumer qui, à l’âge de 17 ans, mène une résistance farouche contre la présence française en Algérie. C’est la première femme héroïne qui a donné du fil à retordre aux troupes du général Randon. Elle a vécue vierge toute sa vie. Elle est surnommée la Jeanne d’Arc du Djurdjura et décrite comme «la grosse et volumineuse beauté».
C’est une prophétesse berbère et cheffe d’une Tarika soufie. Arrêtée en 1875, elle meurt à l’âge de 33 ans, suite à une longue maladie. Les résistances populaires contre l’occupant français ont été nombreuses, conduites par El Hadj Amar (1853-1857), Cheikh Seddik Ben Arab (1854-1857), Si Saddek Ben El Hadj (1858-1859), La résistance du Hodna (1860), La révolte de Ferdjioua, Zouagha et les Babors (1864), La Rahmania (1871), La révolte des Aurès (1871 et 1879) et des Béni Menacer à Souk El Had, La révolte de l’Oasis d’El Amri (1876).
Pour mémoire, on peut noter d’autres révoltes, dont celle du Cheikh Boumaza, des Aurès, des Ouled Sidi Cheikh, des Touareg, des Snoussia de Djanet, Ouargla et Tamanrasset… Toutes ces révoltes sont l’accumulation de misères, de mauvaises récoltes, de famines (1876-1868), l’accaparement des terres par les colons et la perte d’influences des féodaux, anciens alliés de la France, tout cela va les rassembler dans la révolte contre l’occupant français. En 1860, Napoléon III propose «un royaume arabe» en associant les élites musulmanes, mais en vain, c’est l’échec. Le décret d’août 1868 reléguant les attributions de l’administration militaire aux colons mit le feu aux poudres. Le 24 octobre 1870, le décret Crémieux, objet d’une discrimination, accorde aux juifs d’Algérie le privilège à la nationalité française et aux droits qui en découlent. Ce qui provoqua l’indignation du Bachagha El Mokrani : «Je ne me soumettrai jamais à un juif, je préfère mettre mon cou sous un sabre pour être décapité, plutôt que d’être sous l’emprise d’un juif…
Cela ne se produira pas, jamais, jamais…». Diviser pour régner, le décret les sépara des musulmans bientôt soumis au drastique code de l’indigénat. La raison de l’antisémitisme a servi durant plus d’un siècle à expliquer l’insurrection. Les spahis algériens lors de la guerre franco-prussienne de 1870 ont montré leur courage en évitant une boucherie sans précédent au gros de l’armée française. Ce sont les spahis de Ain Guétar près de la frontière tunisienne qui se mutineront les premiers. En 1871, le racisme savant d’Ernest Renan au service de l’œuvre coloniale écrit : «La conquête d’un pays de race inférieure par une race supérieure, qui s’y établit pour gouverner, n’a rien de choquant…», pour le coloniser. «Une race de maîtres et de soldats : c’est la race européenne» et ceci bien avant le dictateur Adolph Hitler, fondateur du nazisme. Cette année, la France est vaincue par la Prusse. La grande insurrection éclata le 23 janvier 1871 puis va se propager dans toute la Petite Kabylie durant presque une année. Les préparations à la révolte vont commencer dans les cafés, les arrière-cours des boutiques et les mosquées.
L’appel au djihad
«L’insurrection kabyle» et le Mouvement insurrectionnel de 1871, c’est le duo exceptionnel : Mokrani Boumezrag et Cheikh El Haddad, contre les confiscations de terres en Kabylie. La dépossession des terres ouvrira la voie à la colonisation de peuplement et sera la conséquence majeure de l’insurrection de 1871. La terre est l’unique moyen de survivre pour les fellahs mais aussi très convoitée par les colons avec l’aide des militaires français. Le samedi 8 avril 1871 au souk de M’cisna à Seddouk, le jour du marché, Cheikh El Haddad, soutenu par ses deux fils, après avoir dirigé la prière, appela ses fidèles à l’insurrection. Il fit lire une fetwa et proclama le «djihad», la guerre sainte en désignant ses deux fils «nouab» (ses représentants).
C’est la plus importante des révoltes avec le soulèvement de près de 250 tribus, soit plus de 120 000 combattants, qui vont se rallier à l’appel de Cheikh El Haddad. C’est sous les ordres de Boumezrag Mokrani et de Cheikh El Haddad à Seddouk Oufella, en Petite Kabylie. Deux grands chefs marquèrent cette époque. Il s’agit d’un ascète soufi révolutionnaire, Cheikh El Haddad, chef spirituel de la confrérie Tarika El Rahmania et grand leader charismatique du soulèvement de 1871, et d’un chef de guerre, le Bachagha (haut dignitaire) Mohamed Mokrani, grand frère de Boumezrag Mokrani. Tous deux se complétant. L’un chef spirituel et moral, l’autre administrateur et chef de guerre. Les causes qui ont engendrés cette insurrection d’avril 1871 étaient, en premier lieu, ces mesures répressives mises en branle par le colonialisme français contre la paysannerie algérienne, qu’il a dépossédée de ses terres par des moyens illégaux, afin d’installer par voie de conséquence un grand nombre de colons européens sur d’immenses superficies agricoles. C’est une révolte populaire «pour la terre» et la riposte des forces d’occupation française a été sans égale pour réprimer toute idée d’indépendance. D’autres causes sont énumérées par les historiens : souveraineté nationale, dégradation des conditions de vie, épidémies (choléra, typhus…), l’injustice des colons en confisquant les terres et en leur faisant payer des taxes, l’offensive d’évangélisation en Kabylie et dans d’autres contrées…
Les Mokrani, grande famille aristocratique dévouée à la France, perdent certains privilèges et se révoltent contre les humiliations subies de la part des autorités locales. Le 25 mars 1871, le commissaire extraordinaire de la République française publie un arrêté de séquestre des biens des Mokrani et de ses adhérents.
Une répression terrible, tous les biens immobiliers et mobiliers des tribus insurgées ayant échappé au pillage et à la destruction furent confisqués. Un véritable droit de la dépossession sur les biens des tribus insurgées élabore les conditions futures d’une colonisation de peuplement. La sanction entraîne la confiscation aux Mokrani 5000 hectares de terre pour y installer des colons et créer un centre de colonisation. L’année 1865, c’est celle présumée de naissance de mon grand-père paternel FLICI Abdelkader Ben Lounès (commune de Sidi Moussa). Les colons occupent les meilleures terres agricoles d’Algérie, expulsent les fellahs et imposent des monocultures comme la vigne et les agrumes. La colonie algérienne devient un important grenier agricole pour la métropole. En fait, les quarante premières années de la conquête (1830–1870) se soldèrent pour les fellahs par la perte de plus d’un million d’hectares de terre, dont la plus grande partie est située dans les riches plaines de la Mitidja et terroirs. La résistance armée dura plus de 60 ans et coûta à l’armée française plus de 50.000 morts. La répression après le soulèvement fût féroce. On relève 100 000 Algériens morts avec la confiscation de leurs terres, l’exil vers la Syrie et la déportation des révoltés vers les bagnes de la Nouvelle-Calédonie et Cayenne en Guyane.
Des Algériens déportés à partir de 1864 et jusqu’en 1897. Plus de 2000 Algériens déportés vers la Nouvelle-Calédonie. Et plus de 20 000 vers Cayenne (à partir de 1862). Cheikh El Haddad mourra à la prison de Constantine. Boumezrag Mokrani et ses amis sont exilés en Nouvelle-Calédonie, ils sont internés mais libres de leurs mouvements. Pour l’historienne Sarah Diffalah : «Entre 1864 et 1897, environ 2000 Algériens sont relégués en Nouvelle-Calédonie, dont une centaine de condamnés politiques, instigateurs de la Grande insurrection kabyle de 1871.» Un demi-siècle de résistance, notion d’un Etat, d’un territoire, gestation d’un mouvement nationaliste, une prise de conscience et un sentiment identitaire. Les confréries religieuses en Algérie (Quadiriya, Chadeliya, Aissaouiya, Cheikhiya, Zianiya, Taibiya) et la plus importante la confrérie Rahmaniya fondée par Sidi M’hamed Ben Abderrahmane surnommé «Bouqebrine» (Le Saint aux deux tombes) ont contribué dans la conservation de la culture musulmane et sa propagation en Afrique noire. Lors de mon séjour récent en Algérie, j’ai eu l’occasion de rencontrer et de discuter avec Athmane, l’arrière-petit-fils de Cheikh El Haddad à Seddouk Oufella, dans la wilaya de Béjaïa. J’ai ainsi pu visiter la petite chambre de Cheikh El Haddad (cf. Photos), apprécié ce qu’a été la vie de ce grand soufi, hors du commun, doté d’une grande intelligence et d’une immense sagesse.
Des femmes, des hommes viennent à ce jour se recueillir régulièrement chez lui et au mausolée du village où se trouvent les tombes de ses deux fils M’hand et Ziad. Pour la population, c’était un grand homme de foi, qui transmettait son savoir aux jeunes du village dans sa médersa et assurait l’éducation de la morale islamique pour les adultes dans sa propre mosquée à Seddouk Oufella.
Cet homme exceptionnel m’a incité à faire des recherches sur sa vie. Je reviendrai plus en détails sur ce personnage et je citerai les témoignages de ses descendants sur ce qu’était la personnalité de ce grand résistant contre la présence coloniale française en Algérie.
C’est Athmane qui s’occupe du mausolée, nettoie bénévolement et vit dans la pièce de son arrière-grand-père de deux mètres carrés, sans lumière, ni sanitaires, ni lavabos, une petite lucarne fermée. Au cours de notre rencontre, Athmane m’a offert des livres anciens et introuvables sur l’histoire de Cheikh El Haddad. Il m’a tout donné. Un brave homme, un cœur d’or, perdu dans les montagnes de la Kabylie. Chaque fois que je viens en Algérie, je passe le voir. En lui souhaitant longue vie.
Par FLICI Omar
Gynécologue-obstétricien

Flici Omar et Athmane le petit-fils de Cheikh El Haddad à Seddouk Oufella
-----------------------------------------
Références bibliographiques :
Ali Battache : La vie de Cheikh El Haddad et l’insurrection de 1871. Ed. El-Amel, 2017.
Les Actes du Colloque sur la vie de Cheikh E lHaddad, Ed. Bougie Sedouk. 2011.
Tahar Oussedik : Mouvement insurrectionnel de 1871. Ed. ENAG. 2009.
Larbi Beddar : Cheikh Aheddad De la Tariqa Rahmanya à l’insurrection d’avril 1871. Essai. Ed. Belles-Lettres. 2011.
Mouloud Gaïd : Mokrani. Ed.
Mimouni. 2009.
Mehdi Lallaoui : Kabyles du Pacifique. Collection «Au Nom de la Mémoire»
Mausolée CHEIKH El Haddad et ses deux fils à Seddouk Oufella (Photo personnelle)