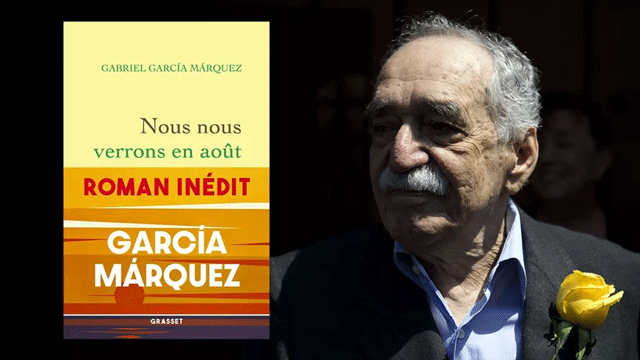Nous nous verrons en août», grâce à Internet j’ai lu quelques pages du roman inédit de Gabriel Garcia Marquez publié à titre posthume, dix ans après sa mort.
Dès les premières lignes, on est pris, subjugué, non pas par le style, les descriptions ou les personnages, laissons cela aux puristes parfois inquisiteurs, mais par la vie qui se dégage de ce roman d’un mort. Et à lire les présentations du livre, il s’agit d’une œuvre pleine de passion et de sensualité à l’occasion, encore une fois, d’une réflexion sur la vie.
Au-delà de Gabriel Garcia Marquez, il faudrait retenir ce souffle de la vie que porte en elle la littérature et qui non seulement confère à chaque livre une âme mais, aussi, la donne à lire. Une âme qui semble survivre à l’auteur, à l’instar de Marquez, l’écrivain colombien ou de tant d’écrivains algériens disparus, mais dont les écrits, frais comme un matin à Constantine, pour évoquer Malek Haddad ou aussi subversifs qu’un exproprié, pour se remémorer Tahar Djaout, s’offrent, si pleins de vie, comme neufs, à nos yeux éblouis.
La littérature conjure le temps et la mort et chaque livre de Djaout le prouve tant par le contenu que la pérennité, opposant aujourd’hui, comme hier, la lumière de l’enfance, du rêve et de la nature, de la vie et de la sensualité aux «inventeurs du désert» toujours si vigilants. Malek Haddad, quant à lui, démontre que le suicide littéraire n’est pas celui de l’œuvre littéraire et que si la source s’est volontairement tarie, l’eau puisée continue miraculeusement à couler à chaque lecture des livres de l’écrivain, telle cette source Jijelienne dite des doléances, Aïn Mchaki, où l’eau, pourtant absente, coule, dit-on, à chaque appel à la prière.
Les livres de Malek Haddad, de Tahar Djaout, d’Abderrahmane Benhadouga, de Rachid Mimouni, de Merzak Bagtache ou de Mouloud Achour, survivent à leurs auteurs, ou, plutôt, les font vivre, en vivant eux-mêmes aux mains de chaque lecteur. Cet instinct de vie, fort et beau, même lorsqu’il dépeint la noirceur des êtres et la laideur des actes, se retrouve en chaque ligne écrite par le défunt, comme une semence pour la postérité.
Car l’écrivain est un être de lumière, il illumine autour de lui et après lui. Il est un être d’exception en notre poète tunisien Abou El Kacim El-Chabi. Celui-ci n’aura vécu que vingtaine, mais ses poèmes prométhéens vivent pour la postérité, illuminant les êtres et les peuples, lui qui a écrit ces vers éclatants d’un poème justement intitulé «La volonté de vivre» : «Lorsqu’un jour le peuple veut vivre, Force est pour le destin, de répondre, Force est pour les ténèbres de se dissiper, Force est pour les chaînes de se briser !»
Comme Djaout, dont le livre-testament Le dernier été de la raison a été édité à titre posthume, six années après son assassinat en 1993, Saint-Exupéry n’aura pas vécu la publication de Citadelle, son œuvre, toute aussi testamentaire, en 1948, lui disparu en mer, quatre ans auparavant. Mais qu’est-ce qu’un testament littéraire ? Au-delà des personnes et des nationalités, n’est-ce pas un legs universel d’idées et de conceptions ?
Une vision du monde qui transcende les horizons étroits, pour toucher à l’essentiel : ce qui fait l’homme. C’est pourquoi tant Marquez, Haddad et Djaout, mais aussi Shakespeare, Tayeb Salih ou Dostoievski, marquent chaque époque dans leur pays ou ailleurs, selon le succès des uns et des autres et les fractures qui ne sont pas seulement numériques du monde dans lequel nous vivons. Un monde qui a besoin de la vie portée en et par chaque œuvre littéraire, car dans un monde rempli de violence(s), sous toutes les formes, la vie, sous toutes ses formes, se doit d’être défendue, promue et chantée.
Ainsi, la littérature, sous toutes ses formes aussi, est une ode à la vie qui fait reculer à chaque page de livre, digne de ce nom, la violence du monde et des êtres, toute cette énergie négative dont on veut faire le moteur du monde. Il n’est pas inutile de rappeler, ici, un passage du fameux discours de Soljenitsyne écrit à l’occasion de son obtention du prix Nobel de littérature en 1970 : «On nous dira que peut la littérature contre la ruée sauvage de la violence ? Mais n’oublions pas que la violence ne vit pas seule, qu’elle est incapable de vivre seule : elle est intimement associée, par le plus étroit des liens naturels, au mensonge et les écrivains et les artistes (…) peuvent vaincre le mensonge.»
Les écrivains peuvent, en effet, vaincre le mensonge et la violence, par leur écriture même, par ce vouloir s’exprimer, qui est aussi un vouloir-vivre, par cette énergie que dégage l’acte d’écrire, qui participe de la création, acte de vie par excellence. D’autant qu’à l’écriture s’adjoint la lecture que réalise, toujours dans un élan vital, le lecteur.
De cet échange, de cette interactivité, naît justement une nouvelle étincelle de vie, une nouvelle «poudre d’intelligence» (pour reprendre un titre de Kateb Yacine) qui s’avère essaimer à partir d’une œuvre pour marquer les esprits de quelque époque qu’ils soient, même longtemps après la disparition de son auteur.
Le monde a certes vu, ce 13 mars, pour l’édition en langue française, la publication d’un nouveau livre de Gabriel Garcia Marquez, malgré la mort de celui-ci, mais en fait cette publication n’est point posthume, car l’écrivain vit en chacun de ses livres et Marquez vivait et vit toujours en les siens, grâce à ses idées, à ses récits, à son écriture, grâce à la littérature, qui est aussi la vie.
En fait, nous ne nous verrons pas seulement en août, mais aussi en ouvrant chaque livre, quelque soit le mois et l’année. Nous nous verrons pour l’éternité.
Par Ahmed Benzelikha , linguiste spécialiste en communication, économiste et journaliste