Le roman intitulé Les Gens du Peuplier (Editions Casbah, 2023) a été présenté mercredi au TRO en présence de son auteur, l’écrivain et journaliste Arezki Metref. La rencontre, suivie d’une vente-dédicace, a eu lieu dans le cadre des journées littéraires d’Oran qui se tiennent désormais à la mémoire du défunt Hadj Meliani, chercheur universitaire et enseignant en littérature, maghrébine notamment, dont un hommage particulier lui sera rendu le 21 mars.
Ce n’est pas un roman autobiographique, prévient-il dans son intervention même si, comme lui, des personnages, qu’il décrit, ont vécu, enfant ou adolescents, les dernières années de la guerre d’indépendance du pays et ont souvenance de l’espèce de transition qui a caractérisé la période qui s’en est suivie juste après, «lorsque les choses n’étaient pas encore tout à fait claires».
Le décor est planté dans une toute nouvelle (pour l’époque) cité de la banlieue d’Alger : «De façon paradoxale, nous nous trouvions un peu dans la situation d’une colonie de peuplement dont les membres auraient fait table rase de leur passé et de leur provenance pour n’être plus que des hommes neufs, nés à une nouvelle vie. A cette différence près que nous étions aussi les colonisés», est-il noté dans un passage pris au hasard au début du roman décrivant l’arrivée des habitants, près de quatre ans avant l’Indépendance.
Mais pour mettre au parfum son auditoire, l’auteur a dû pendant de longues minutes tenter de résumer le contexte, évoquer le destin de ses personnages, mais encore plus intéressant, parler de ses motivations et ses choix littéraires qui tiennent compte des performances orales. Le don de raconter des histoires n’est pas seulement l’apanage des gens lettrés et c’est sans doute pour cela qu’une partie du livre porte l’intitulé, le jeu de mots mis à part, «Omar notre Homère».
Arezki Metref évoque comment des gamins mutualisent leur maigre argent de poche pour permettre, tour à tour, à un de leurs camarades d’aller au cinéma voir un film, à condition de le raconter à la sortie. L’un d’eux est capable de raconter pendant des heures un film d’une heure et demie et c’est en général le prélude à la naissance des vocations. Justement, le roman tourne aussi autour du cinéma et c’est le destin du personnage principal de bénéficier d’une formation en Union soviétique pour ensuite devenir un scénariste reconnu à Hollywood en voyant son travail «oscarisé».
Le roman est sorti l’année dernière, mais l’intrigue dont il s’agit s’arrête à des années auparavant. Vu sous cet angle, on voit bien la jonction avec l’histoire et le passage de l’Algérie de l’option socialiste au «libéralisme». L’auteur explique que le choix de Hollywood est motivé par le fait que, qu’on le veuille ou non, le cinéma américain domine le monde mais hormis le fait indéniable de cette industrie florissante (blockbusters ou pas), à Hollywood, il est aussi question de star system et son corollaire la réussite individuelle à tout prix. La présentation du livre a été telle que chacun des participants à la rencontre a été interpellé par un aspect ou un autre des thématiques développées oralement.
Et c’est ainsi que l’idée selon laquelle il est nécessaire de s’exiler pour réussir a été également posée mais conscient des réalités, Metref a bien fait de rappeler également le déclassement subi par la majorité des migrants algériens au Canada, par exemple avec des médecins qui se retrouvent chauffeurs de taxi, pour ne citer que ce cas-là précis. Ceci plutôt que cela, mais c’est le propre de l’attractivité des nations dominantes, les premières héritières de la révolution industrielle, qui continue à façonner le monde d’aujourd’hui.
Dans les échanges avec le public, il a été tout autant question du devenir de la lecture, des problèmes d’édition, le la censure mais aussi et tout simplement de la langue. «Pourquoi continuez-vous à écrire en français alors que cette langue est appelée à disparaitre en Algérie ?» Cette question a fait sursauter plus d’un avant même que l’intervenant qui l’a formulée n’ait eu le temps d’ajouter que ce serait au profit de l’anglais. En dehors de toute considération, la question n’est peut-être pas à prendre à la légère, sachant que les langues peuvent effectivement relever autant de choix, de décision que de domination politique ou autre.
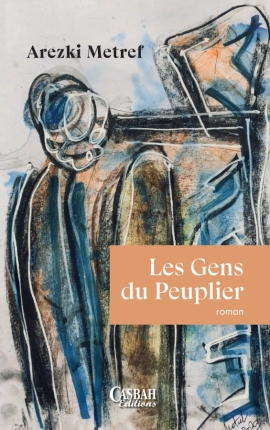
A condition de se donner les moyens nécessaires, toutes les perspectives sont en théorie envisageables, y compris bien sûr le développement des langues maternelles en usage en Algérie que sont l’arabe et le berbère. L’erreur serait par contre de vouloir se justifier en considérant que ce sont les langues qui font le progrès technologique ou que, sur un plan idéologique, la langue anglaise est reliée à un passé moins colonial que le français.
Sur un tout autre registre, un autre intervenant a raconté que lui-même, adolescent, il a eu à vivre le tragique attentat de l’OAS perpétré le 18 février à Medina J’dida, dont la ville d’Oran venait par ailleurs de commémorer la date. Il a déclaré souhaiter avoir le don d’écrivain pour en faire là aussi un roman comme pour signifier que le sujet reste à exploiter en littérature. «Les écrivains de la génération d’aujourd’hui s’intéressent aussi à la période coloniale, mais j’aurais aimé lire un roman sur les événements d’Octobre 1988 par exemple», répond l’auteur des Gens du Peuplier qui s’est visiblement senti obligé de répondre à des questions qui fusent dans tous les sens.
Dans la présentation, il a été aussi question d’une de ses chroniques dans Le Soir d’Algérie concernant justement la possibilité de séparer la tête du corps pour se donner du répit. Mais un autre est plus significatif pour la rencontre concernant notamment le cinéma. Il raconte avec humilité comment, par un concours de circonstances indépendantes de sa volonté, il a été amené, jeune journaliste, à aller interviewer le grand cinéaste égyptien Youcef Chahine de passage à Alger et comment il s’est fait gronder par ce dernier en osant se présenter devant lui sans avoir vu son film.
Une manière de dire «de quoi veux-tu qu’on parle, du prix de la pomme de terre ?» C’est aussi l’humilité d’un réalisateur qui a toujours voulu qu’on accorde de l’importance aux œuvres qu’il faut d’abord regarder ou, comme c’est le cas ici, lire.


