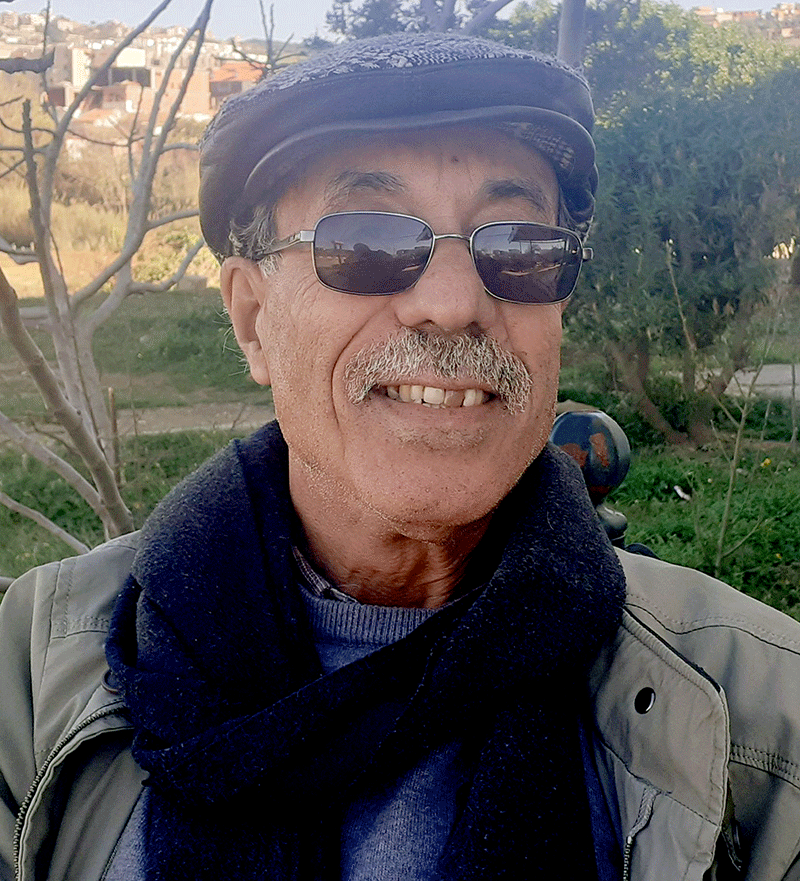L’écrivain Sari Mohamed dont la notoriété dépasse nos frontières, de retour du Caire, sirotait son thé, seul sur la terrasse d’un café. Il affiche sa disponibilité pour répondre à nos questions, avant de reprendre sa route vers à Alger. Le célèbre romancier et traducteur (français, arabe, tamazight) aime se ressourcer chez lui, à Cherchell. Sans détour, il n’a pas hésité à «débiter» ses vérités sans filtre, ses sentiments, toujours avec son léger sourire.
- Vos impressions après votre participation au dernier SILC...
Je précise que le Salon international du livre du Caire (SILC, ndlr) a été organisé du 26 janvier au 7 février. La première chose qui a retenu mon attention, c’est l’infrastructure qui avait abrité cet événement international dédié aux activités culturelles en général, mais surtout au livre en particulier.
Les autorités égyptiennes avaient démontré leur attachement au livre, à travers la construction d’une grandissime infrastructure superbement aménagée et compartimentée, pourvue de toutes les commodités. Les visiteurs, les écrivains et les éditeurs étaient à l’aise.
Certes, elle a été érigée légèrement loin de la ville. Néanmoins, la disponibilité du transport a favorisé une excellente fréquentation à ce salon du livre. Les familles et les écrivains ne s’ennuyaient pas malgré plusieurs heures passées dans ce lieu, car il y a des espaces qui abritaient des activités commerciales, musicales, théâtrales et les expositions des produits de l’artisanat et du terroir.
L’autre fait marquant, indéniablement c’est l’impressionnante participation des maisons d’édition des pays arabes, en plus de celles du pays organisateur. Les organisateurs avaient réservé un petit pavillon pour l’Algérie. Le ministère de la Culture et des Arts avait délégué l’ENAG pour occuper le pavillon algérien. Ce n’est pas la faute aux organisateurs.
Un pavillon trop insignifiant pour notre pays. J’ai constaté la très forte participation des éditeurs syriens, irakiens et libanais, des pays en guerre pourtant, qui traversent des crises sécuritaires, sociales et économiques. En plus de ces éditeurs, j’ai pu relever la présence des éditeurs d’autres pays arabes, en l’occurrence le Sultanat d’Oman, le Qatar, les Emirats arabes unis, ainsi que d’autres.
En tant que citoyen algérien, j’ai déploré l’absence des éditeurs de mon pays, quand je pense que les autres éditeurs des pays arabes ont proposé leur participation à ce Salon international du livre. Ce n’est pas la première fois que les éditeurs algériens s’illustrent par ces absences aux Salons internationaux du livre. Le nombre de titres édités par les Egyptiens est monstrueux. L’Egypte a démontré que c’est un pays de culture. Je suis jaloux et frustré face à ce constat amer que je viens de relever au Caire.
- Y a-t-il eu un engouement au SILC ?
Les organisateurs ne s’attendaient pas à une météo inhabituelle. Il faisait froid. L’éloignement de l’infrastructure n’a pas découragé les marées des étudiantes et des étudiants qui convergeaient vers ce lieu de culture. La pandémie du Covid-19 n’a pas impacté sur le déroulement de la manifestation, bien que les mesures sanitaires étaient exigées.
- Qui sont ces Algériens qui avaient participé à ce Salon international ?
Trois écrivains algériens qui avaient publié leurs œuvres littéraires à la maison d’édition égyptienne Dar El Aïn. Il s’agit du journaliste de la chaîne Chourouk TV, Rédouane Rochdi, de la romancière et poétesse, fonctionnaire de surcroît, Mme Melhag Fadhéla, et l’enseignant universitaire Bouzid Harzellah. J’ajouterai ceux qui avaient été primés à l’échelle internationale pour leurs romans, en l’occurrence Ahmed Tibaoui et Aïssaoui Abdelwahab.
- Je reviens sur l’objet de votre participation au SILC...
J’ai participé à ce salon avec mes deux romans. Le premier constitué de 370 pages est édité par Dar El Aïn au Caire. Il a pour titre Les feux de Oued Aïzer. J’ai patienté 18 mois pour son édition. Le second livre s’intitule Le moissonneur de sable (270 pages) est édité chez Mauguin. Il s’agit d’une histoire qui relate l’après-période du terrorisme vécue en Algérie.
Par ailleurs, j’ai eu droit à une émission hebdomadaire de 45 minutes sur la chaîne TV Nil Culture. Les organisateurs avaient fait passer aussi en boucle mon intervention enregistrée d’une durée de 15 minutes au salon. Malheureusement, la participation algérienne au SILC a été confirmée en dernière minute. Les organisateurs avaient déjà arrêté leurs programmes de conférences.
Même la participation des écrivains algériens avait eu lieu dans la précipitation. L’improvisation. Il n’en demeure pas moins que j’ai pu assister et participer à une conférence sur Nawel Sâadaoui. D’ailleurs, mon intervention a plu au public. J’avais enseigné l’un des romans de Nawel Sâadaoui à l’université à Alger. Ma compatriote et poétesse Fadhéla Melhag avait déclamé ses poèmes devant une assistance nombreuse.
- Et si on parlait de la situation du livre en Algérie...
En Algérie, il n’y a pas de volonté de la part des autorités. Notre pays est pourvu d’écrivains, de poètes, de critiques littéraires. L’architecture de la SAFEX ne répond plus aux exigences de l’organisation actuelle d’un salon du livre, à l’instar de celui du Caire.
- Etes-vous toujours le président du Conseil national des arts et lettres (CNAL) ?
Non, non, je n’y suis plus depuis la fin du mandat, au mois de juillet 2021. Notre ministère de la Culture n’a pas jugé utile de renouveler la composante du bureau. Les missions du CNAL ont été dévoyées.
On m’a enfoncé dans un engrenage, en étudiant les milliers de dossiers et en délivrant les cartes d’artistes. J’ai fait face à beaucoup de problèmes avec des personnes qui voulaient obtenir leur carte d’artiste, pour pouvoir demander des visas et partir à l’étranger.
Je suis un écrivain. Je suis déjà pris par mon emploi du temps chargé. Il m’a été impossible de supporter cette anarchie. Selon le décret de création de ce Conseil consultatif, on devait se réunir jusqu’à trois fois par an, pour proposer des solutions au secteur de la culture au pluriel, afin de donner un rôle plus actif et positif à ce secteur.
Dès que mon mandat a expiré, j’ai quitté le bureau. J’ai gardé le cachet officiel, dans l’attente de la désignation d’un nouveau responsable du CNAL. Tout dépendra du ministère de la Culture.
- Et si on parlait des problèmes des éditeurs, vus à travers le prisme d’un écrivain...
Quand on décortique le pourquoi des problèmes que rencontre le marché du livre, on peut avoir une idée sur les difficultés des éditeurs et des écrivains. L’autre hypothèse, c’est le nombre trop insignifiant des citoyens qui lisent encore les livres. Si on parle du présent, la maison d’édition édite au maximum 500 exemplaires, alors que durant les années passées, le nombre d’exemplaires était multiplié par huit.
Avec les nouvelles technologies, on arrive même à éditer jusqu’à 250 exemplaires, mais dans ce cas précis, le prix du livre est déjà trop élevé à la sortie des machines. L’éditeur devra produire un livre de bonne qualité. Certains éditeurs éditent des œuvres pleines de fautes grammaticales et des fautes typographiques. C’est anormal. Ils doivent faire un effort, dans la correction, l’infographie, et j’en passe.
Franchement, en Algérie, il n’existe pas des éditeurs professionnels, hormis quelques-uns qui se comptent sur les doigts d’une seule main. L’éditeur algérien ne s’aventure pas avec l’écrivain.
C’est l’une des raisons qui incite les écrivains à partir en France, en Egypte et au Liban, pour tenter d’éditer leurs œuvres. Nos éditeurs ne voyagent pas et ne participent pas aux salons du livre en dehors de l’Algérie. Je trouve personnellement que l’éditeur algérien est un commerçant qui se plaint uniquement, sans engager des initiatives adaptées allant dans le sens de la promotion du livre.
Le syndicat du livre devra faire des propositions de lois, afin de trouver des solutions aux problèmes du livre. L’Algérie est un pays fermé. Exporter ou importer le livre est devenu un obstacle. Il faut se replonger dans les années 70, pour voir comment les Algériens alimentaient leur esprit et enrichissaient leur culture grâce à la disponibilité des livres et revues. L’Algérie comptait au temps de Khalida Toumi mille éditeurs. Ils ont profité des aides de l’Etat. C’est utopique.
- Cela se complique de plus en plus avec la situation actuelle...
On vient d’être informé que la grande librairie d’Oran vient de fermer. C’est le résultat du marasme que vit le marché du livre en Algérie. Or, Oran prépare les J. M. et voilà qu’une libraire est en faillite. Il y en a d’autres librairies qui sont fermées dans tout le pays.
L’autre fait que beaucoup ignorent, c’est que l’auteur contribue financièrement à l’édition de son œuvre. La maison d’édition en Algérie fonctionne avec le financement de l’écrivain. Est-il normal ce phénomène ? C’est une édition à compte d’auteur.
- Un véritable engrenage, n’est-ce-pas ?
Il ne faut pas se leurrer. L’Algérie n’a jamais eu un grand lectorat, d’autant plus que la jeunesse des dernières décennies, on a assisté à un divorce du lectorat national avec le livre. Les réseaux sociaux ont pris le dessus. Les librairies ne sont plus fréquentées. Les écrivains algériens ne vivent pas de leur plume.
- Mais où est alors la solution avec ce constat qui fait mal ?
Non, non ! J’estime que la solution existe. Il suffit de cibler sérieusement les publics. En Algérie, il existe une cinquantaine de centres universitaires. Dans ces universités, il y a plusieurs départements, en l’occurrence les lettres, les sciences sociales, humaines, etc.
C’est un terreau, où il y a des lecteurs potentiels. Les chefs des établissements des cycles du secondaire et du moyen peuvent acheter pour la distribution des prix de fin d’année les livres des auteurs algériens. Ils peuvent inviter les auteurs lors de la cérémonie de distribution des livres aux lauréats. J’ai vécu personnellement des expériences extraordinaires dans cinq lycées à Alger et dans deux lycées et un CEM en France.
Le contact avec les élèves et leurs parents mérite d’être renouvelé au moins une fois par an. Chaque établissement scolaire est pourvu d’une salle de lecture. Les bibliothèques principales dans les wilayas du pays peuvent prendre l’initiative pour acheter les œuvres littéraires et inviter leurs auteurs. Voyez-vous la quantité de livres à commercialiser dans ces lieux du savoir ?
Ces universités et établissements scolaires relèvent de différents ministères. Ils n’achètent pas les petits lots des livres des auteurs algériens, édités en Algérie, sans obtenir l’autorisation de leur tutelle. La bureaucratie et l’immobilisme.
On peut citer le ministère de l’Education nationale, celui de l’Enseignement supérieur, celui de la Culture, celui de la Jeunesse et des Sports. J’avais préparé l’anthologie des écrivains algériens dans les deux langues, l’arabe et le français. En outre, les éditeurs doivent organiser des mini-salons dans les universités, les établissements scolaires, les bibliothèques, les centres culturels. J’estime que les solutions sont à notre portée.
- Est-il possible d’initier vos propositions en Algérie ?
Il ne faut pas se voiler la face. Il y a un problème de politique du livre dans notre pays. Cela est décourageant. L’Etat n’accepte pas aussi les écrivains rebelles. Cette absence d’initiative, de volonté est à l’origine des problèmes que rencontre le marché du livre.
Il n’y a pas un véritable débat, en mesure de changer la situation du livre. Les réseaux sociaux peuvent être aussi utilisés à bon escient, pour informer les internautes sur les écrits littéraires, sur les événements culturels, leurs lieux, leurs dates et la présence des auteurs.
- Votre dernier mot...
La matière existe en Algérie. Elle mérite d’être prise en charge, d’être mise en valeur, grâce à une politique transparente et démocratique dans la gestion du marché du livre. Les bonnes volontés doivent être encouragées par les décideurs, locaux et centraux.
Ces volontés ne doivent pas être prisonnières de la bureaucratie. Je suis jaloux depuis mon retour à Alger, après ma participation aux Salons internationaux du livre.